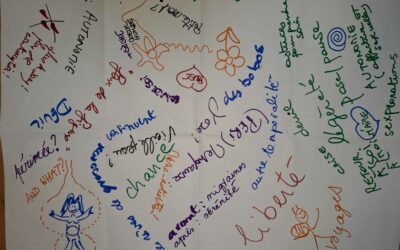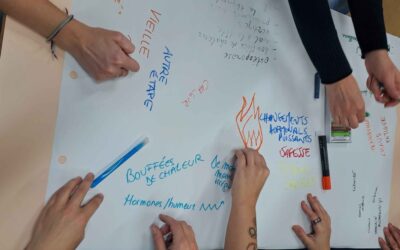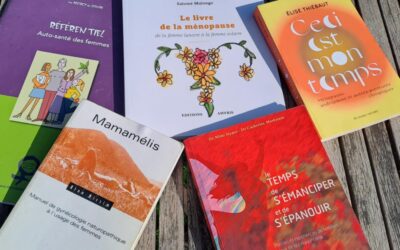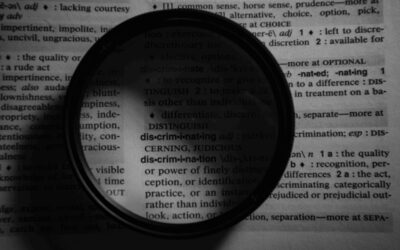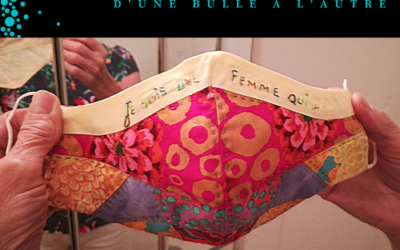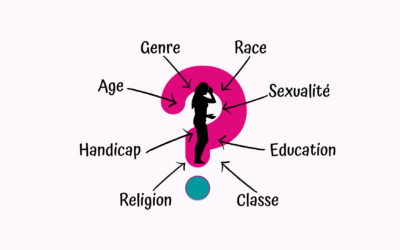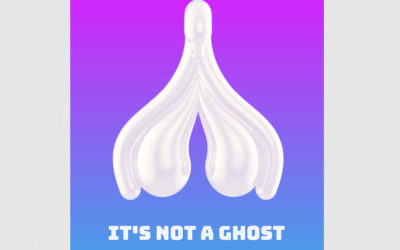Le moment propice pour re-gagner en liberté et pour prendre soin de soi !
Analyses
La ménopause : une question biologique ?
C’est la cacophonie dans notre « orchestre hormonal » : bientôt une nouvelle symphonie !
Ménopause : question de terme et d’histoire
A qui profite la vision médicale actuelle ?
La ménopause ou la violence d’un cliché à l’occidentale
La ménopause n’a rien d’universel !
Crever l’écran (et le patriarcat)
Notre chronique est maintenant disponible en version papier
Love Lies Bleeding : réappropriation d’un corps à soi
4e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »
Unbelievable et Quitter la nuit : la justice face aux violences sexuelles
3e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »
Pauvres Créatures : le concept d’agentivité
2e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »
L’auto-santé et ses ramifications
Des origines aux enjeux actuels
Barbie : de la pop culture au feminisme washing
1re analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »
Crever l’écran
Une introduction à notre nouvelle chronique ciné
Révolutionner l’amour romantique
Comment réinventer nos manières d’aimer ?
L’EVRAS : où se cache la manipulation ?
Des amalgames terrifiants
Les enjeux de l’EVRAS : quelques balises
Enjeux historiques et féministes
Espaces publics et perspective de genre
Petit guide pour les débutant·es
Le yoga : un outil de résilience face aux diktats patriarcaux ?
Au-delà des clichés et des stéréotypes de genre
L’autodéfense féministe, un outil d’émancipation et de libération
A quoi ressemblerait un monde sans violence ?
Le corps : un ré-investissement de l’intime
Une nouvelle génération de féministes
En quoi l’écoféminisme participe à la réappropriation du corps ?
Ou comment les femmes assument leur expérience charnelle
La nouvelle loi #Stopféminicide en Belgique
Une avancée oui, mais restons vigilantes !
Le regret d’être mère : la réalité d’une maternité fantasmée ?
Déconstruction d’un idéal maternel
Le pouvoir des mots : enjeu du féminisme
Le langage, haut lieu de la lutte féministe
Violences faites aux femmes en situation de handicap
Les facteurs vulnérabilisants
Un regard genré sur les espaces verts
Présentation de plusieurs champs d’action
Accès aux soins de santé durant la crise sanitaire
Fractures sociales aggravées
Les couples à l’épreuve de la crise sanitaire
Des adaptations diverses et multiples
Télétravail : jongler entre l’intime et le professionnel
La séparation privé/public en voie de disparition ?
Le désir des femmes à l’épreuve du couple
Une injonction contradictoire ?
Des témoignages au podcast, ou comment tisser du commun
Relayer la parole des femmes pendant le confinement
Harcèlement et agressions sexuelles : lois, arrêtés, mesures covid et avancées
Faisons le point.
Au carrefour des discriminations : l’intersectionnalité
Rendre visible la multiplicité des oppressions
En-quête d’orgasme
L’intouchable plaisir féminin
En-quête du clitoris
Un nouvel étendard du féminisme
Émergence des comptes Instagram engagés
Quel impact chez les jeunes ?
La prostitution ou le travail du sexe: un choix ?
Abolir ou réglementer ?
L’accès à l’IVG pendant le confinement
Nombreux sont les freins
Être femme sans être mère
Une lutte féministe encore loin d’être gagnée
Antisexiste, la ville de Louvain-la-Neuve ?
Quelle est la place des femmes ?
Crise de la sécurité des femmes
Le continuum des violences n’est pas en crise
La charge mentale accentuée avec le confinement ?
Avec en supplément : la charge émotionnelle !
Coronavirus : des masques à quel prix ?
De la saga des masques … à la distanciation sociale !
Coronavirus : les femmes en première ligne
Autant de métiers invisibles et dévalorisés considérés aujourd’hui comme essentiels
Nouvelles réappropriations
Notre corps nous-mêmes, nouveaux mots, nouvelles pratiques
La fluidité sexuelle : késako?
Aimer une personne, pas un sexe.
Le slam : une nouvelle voie d’émancipation?
Des femmes s’approprient cet art de la rue pour s’exprimer !
La crise de la pilule
Les femmes, notamment les plus jeunes, sont moins satisfaites qu’auparavant de la pilule. Qu’en est-il du côté des alternatives masculines ?
La responsabilité contraceptive
Les hommes sont-ils prêts à prendre leurs responsabilités, et les femmes sont-elles prêtes à laisser cette responsabilité à leur partenaire ?
Reste à ta place ! Le corps contraint
Inégales face aux injonctions paradoxales sur nos corps.
Les femmes ont-elles vraiment le droit de disposer de leur corps?
Mon corps, nos corps, une histoire pas si intime que ça.
Du Nord au Sud, le coût véritable d’une petite culotte
Quelle valeur donne-t-on aux vêtements et surtout aux vies de celles qui les fabriquent ?
Corps écrits asbl
Siège social et équipe animation
Place de l’Université, 25 – b4
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél : +32 (0)490 46 01 82 / +32 (0)490 46 01 77
Email : info[at]corps-ecrits.be
Envie d’écrire ? Envie d’agir ?
Envie d’écrire autour d’une de nos thématiques ?
De participer à l’élaboration de nos actions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Suivez-nous sur Facebook et Insta !