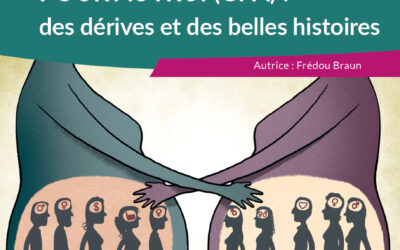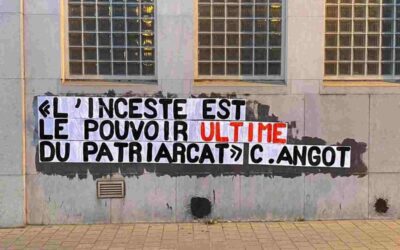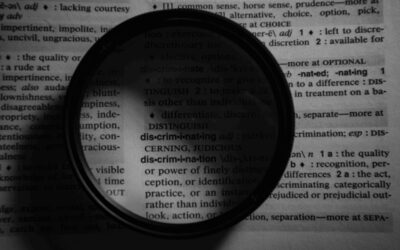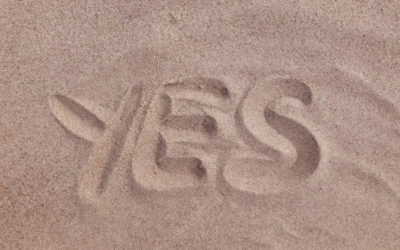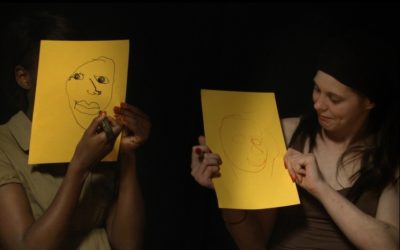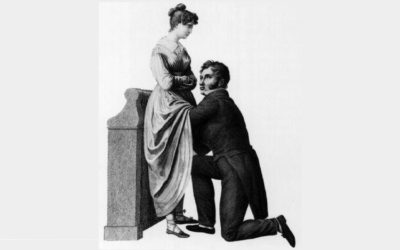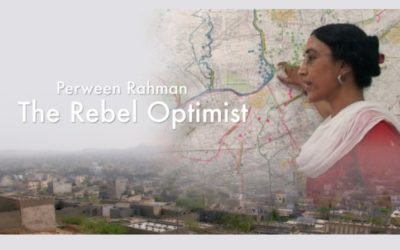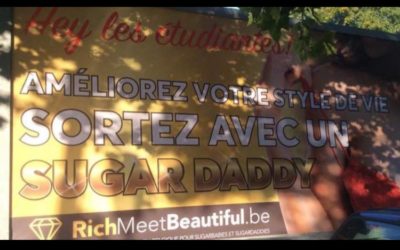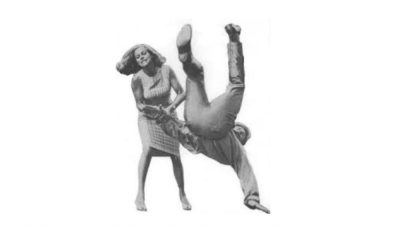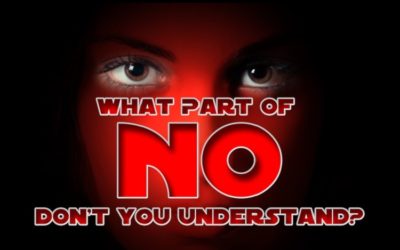La ménopause n’a rien d’universel !
Violences et résistances
Crever l’écran (et le patriarcat)
Notre chronique est maintenant disponible en version papier
Au cœur de la Gestation Pour Autrui (GPA) : des dérives et des belles histoires
Notre étude 2024 est imprimée !
Love Lies Bleeding : réappropriation d’un corps à soi
4e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »
Unbelievable et Quitter la nuit : la justice face aux violences sexuelles
3e analyse de notre chronique « Crever l’écran (et le patriarcat) »
Crever l’écran
Une introduction à notre nouvelle chronique ciné
Révolutionner l’amour romantique
Comment réinventer nos manières d’aimer ?
Espaces publics et perspective de genre
Petit guide pour les débutant·es
Le yoga : un outil de résilience face aux diktats patriarcaux ?
Au-delà des clichés et des stéréotypes de genre
L’autodéfense féministe, un outil d’émancipation et de libération
A quoi ressemblerait un monde sans violence ?
Inceste : une analyse féministe du terme
Focus et décorticage de l’inceste et de l’usage de ce terme en Belgique
Le pouvoir des mots : enjeu du féminisme
Le langage, haut lieu de la lutte féministe
Agressions sexistes et sexuelles à Louvain-la-Neuve
Des initiatives étudiantes aux autorités compétentes
Violences faites aux femmes en situation de handicap
Les facteurs vulnérabilisants
Harcèlement et agressions sexuelles : lois, arrêtés, mesures covid et avancées
Faisons le point.
La prostitution ou le travail du sexe: un choix ?
Abolir ou réglementer ?
Crise de la sécurité des femmes
Le continuum des violences n’est pas en crise
Désir et consentement, même combat?
Le poids du contrat social sur l’accès des femmes à leur désir.
Le slam : une nouvelle voie d’émancipation?
Des femmes s’approprient cet art de la rue pour s’exprimer !
Du Nord au Sud, le coût véritable d’une petite culotte
Quelle valeur donne-t-on aux vêtements et surtout aux vies de celles qui les fabriquent ?
Le danger du nucléaire : un déni collectif ?
En cas de catastrophe nucléaire, les risques réels sont-ils imaginables et surtout gérables ?
La lutte anti-nucléaire : tout un programme !
Les résistances ne cessent pas, la répression non plus.
Les femmes de l’ombre
Les femmes en prison : invisibles ?
Le spécisme : un système de domination parmi d’autres
Quels liens entre les femmes et les animaux ?
L’institution violente de la médecine
Entre croyances et protocoles médicaux, que reste-t-il du soin et de la voix des patient.e.s?
L’institution violente du patriarcat
Tout système institutionnel génère des violences, avec une particularité en ce qui concerne les femmes…
Oui, mais les hommes aussi…
La neutralité de genre dans la lutte contre les violences, question d’équité ?
Elles décident ! Mon corps, mes droits – Témoignage de Ria autour de l’accouchement
Campagne " Les droits sexuels et reproductifs des femmes dans le monde". A l'occasion de la 25e Nuit africaine - Samedi 23 juin 2018 - Domaine provincial du Bois des Rêves - Avec le soutien de la Direction générale de la Coopération au Développement -...
La chambre vide
Le combat d’une mère suite au départ de son fils en Syrie
Les graffeuses autour du monde
« Girl Power » relate l’histoire de femmes à travers le monde qui ont choisi le tag, le graffiti, pour s’exprimer dans l’espace public.
Aménagement du territoire: qui a voix au chapitre?
Le portrait de Perween Rahman, architecte urbaniste pakistanaise engagée nous a inspiré pour faire des ponts entre les résistances citoyennes et collectives, ici et là-bas.
Quelle place pour les femmes issues de l’immigration?
Une dizaine de femmes « témoins », venues de plusieurs pays (Maroc, Congo, Italie, Colombie) avant l’an 2000, ont raconté leur arrivée en Belgique et les moments clés de leur parcours de vie.
Etudiantes… et prostituées?
La campagne publicitaire de RichMeetBeautiful à la rentrée de septembre 2017 nous rappelle soudain que oui, des étudiantes se prostituent !
Faire face au sexisme en Maison de jeunes
Un premier état des lieux des questions de genres en MJ en Brabant wallon
Le harcèlement de rue : quelques balises pour comprendre
Pour mieux comprendre ce que le harcèlement signifie et ses répercussions
Harcèlement dans l’espace public : résultats d’une enquête
Une loi est passée en Belgique, mais reste difficilement applicable… Qu’en est-il du ressenti et des réactions des femmes face au harcèlement?
Quelles réponses collectives face aux féminicides?
La colère des femmes latino-américaines a explosé dans les rues ces dernières années à l’occasion de manifestations massives, en signe de protestation contre les violences, domestiques ou institutionnelles, faites aux femmes.
Réalité, diversité, créativité
Du procès d’un viol au procès DU viol
D’un plan interfrancophone à un réel plan global de lutte contre les violences…
Le Plan interfrancophone contre les violences sexistes et intrafamiliales : une avancée pour les femmes
La violence des femmes
Le viol, ça se cultive?
Cachez ce corps …
Nouvelles balises de la lutte contre les violences faites aux femmes
Prostitution et sens commun
La prostitution étudiante : un phénomène récent
Plaisir des femmes, libérons-nous des clichés!
La puissance de l’empowerment au féminin
Internet comme outil d’éducation sexuelle – Usages et interprétations des adolescent.e.s
Corps écrits asbl
Siège social et équipe animation
Place de l’Université, 25 – b4
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél : +32 (0)490 46 01 82 / +32 (0)490 46 01 77
Email : info[at]corps-ecrits.be
Envie d’écrire ? Envie d’agir ?
Envie d’écrire autour d’une de nos thématiques ?
De participer à l’élaboration de nos actions ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Suivez-nous sur Facebook et Insta !